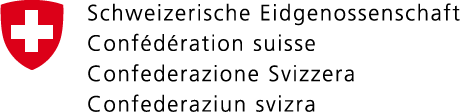Les séances prolongées de négociations qui envahissent l’agenda, Cyril Prissette a dû s’y faire. Lui qui a notamment travaillé pour le HCR en Ouganda ou encore pour le CICR au Liban, dans le Territoire palestinien occupé ou au Kosovo évolue désormais dans une ambiance de travail beaucoup plus confinée au sein de la Mission de la Suisse auprès des Nations Unies à New York. Comme facilitateur de discussions intergouvernementales ou relais d’information pour la DDC, Cyril Prissette dispose d’un regard privilégié sur les tractations diplomatiques qui ont cours. Celles-ci déterminent les contours de l’aide humanitaire qui est déployée lors d’un conflit armé ou suite à une catastrophe naturelle.
Cyril Prissette, de quoi sont faites vos journées à New York ?
Mon rôle consiste à renforcer la voix humanitaire suisse ici au sein des Nations Unies et de diverses organisations multilatérales. Je travaille à promouvoir les positions de la Suisse dans des discussions qui s’avèrent très souvent politisées. En parallèle, j’informe les collègues de Berne du résultat des échanges réguliers entretenus avec nos différents partenaires.
Etre diplomate, est-ce tous les jours facile ?
Je ne peux pas me plaindre. Il y a énormément d’idées qui circulent par ici. C’est très stimulant. Mais c’est un peu déroutant aussi. On n’a pas toujours le temps de se plonger dans tous les dossiers. Le rythme new-yorkais, c’est la course perpétuelle. On court d’un endroit à l’autre… au sens propre, c’est-à-dire d’une mission à l’autre en faisant un passage par le siège des Nations Unies. Je ne peux cacher non plus que je suis de temps à autre gagné par une certaine frustration. Frustration de voir le décalage qu’il y a parfois entre les discussions menées de ce côté de l’Atlantique et les résultats qu’on aimerait voir sur le terrain.
C’est la grande critique qu’on adresse souvent aux diplomates: à quoi servez-vous concrètement ?
Je répondrai en deux temps. Il y a d’abord tout un travail sur des résolutions qui servent de base normative de l’action humanitaire. Je ne parle pas seulement des résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Le Conseil de de Sécurité lui-même prend de plus en plus souvent position sur des situations critiques où la vie de milliers de personnes est en jeu. Pensons à la Syrie ou à la République centrafricaine.
Mais une résolution ne suffit pas toujours à modifier la donne sur le terrain…
C’est clair que la mise en œuvre de certaines résolutions représente un défi. Mais, je voulais précisément évoquer un deuxième niveau de résultats obtenus par la «diplomatie humanitaire»: les avancées réalisées quant aux modalités d’acheminement et d’évaluation de l‘assistance humanitaire à travers le monde. Les discussions régulières entre Etats, agences multilatérales et ONG ont indéniablement contribué à améliorer la coordination de l’aide humanitaire au cours de ces dernières années. Concrètement, l’assistance parvient dans bien des cas plus vite aux victimes parce qu’il y a de meilleures synergies entre les différents acteurs. Lors du typhon Haiyan qui a frappé les Philippines en novembre 2013, plusieurs millions de francs ont pu être mis à disposition en seulement quelques jours. Qui dit coordination, dit meilleure efficacité.
Et traçabilité de l’argent dépensé pour sauver des vies ?
Absolument. Une autre avancée relève d’une plus grande redevabilité des acteurs humanitaires. Des «évaluations post-assistance» et des mécanismes de contrôle permettent de voir si l’aide offerte a été adéquate. Est-ce que les bénéficiaires ont en vraiment profité ? Est-ce que leurs besoins essentiels ont été pris en compte ? Les a-t-on consultés afin d’obtenir le meilleur ratio possible entre investissements engagés et impact obtenu sur le terrain ? Tout cela, comme beaucoup d’autres aspects de l’action humanitaire, découle pour une large part des tractations diplomatiques menées à New York.
A propos, une nouvelle résolution du «segment humanitaire» du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a été adoptée à la fin du mois de juin. Résolution qui vous a passablement occupé, semble-t-il…
Oui, j’agissais au nom de la Suisse qui co-facilitait le processus de négociation avec le Bangladesh. Dans ce cadre, l’idée est de trouver des compromis acceptables par tous les Etats. Au final, la résolution a permis quelques progrès sur la question des déplacements forcés et de l’éducation des enfants affectés par les crises humanitaires. C’est la deuxième année que la Suisse était invitée à co-faciliter les discussions.
Est-ce que la réputation de la Suisse joue en sa faveur ?
D’abord, je pense que les Etats avaient été très satisfaits de notre arbitrage «équilibré», l’année dernière. Ensuite, il est évident que la Suisse peut capitaliser sur son image de neutralité et de bâtisseuse de ponts. Mais j’ajouterai que la Suisse est aussi perçue comme un acteur prépondérant sur certaines thématiques comme l’efficacité de l’aide, l’accès aux victimes et leur protection. D’un côté, les références aux Conventions de Genève sont constantes. De l’autre, la Suisse se profile sur les nouveaux enjeux de l’aide humanitaire. La consultation préparatoire au Sommet humanitaire mondial de 2016 aura lieu à Genève. Il y sera question des défis liés à la nouvelle typologie des conflits, de la gestion des risques, de l’articulation à améliorer entre interventions humanitaires et aide au développement, entre autres sujets. Sur tous ces points, la Suisse possède une expertise et un crédit qui sont pris en compte.